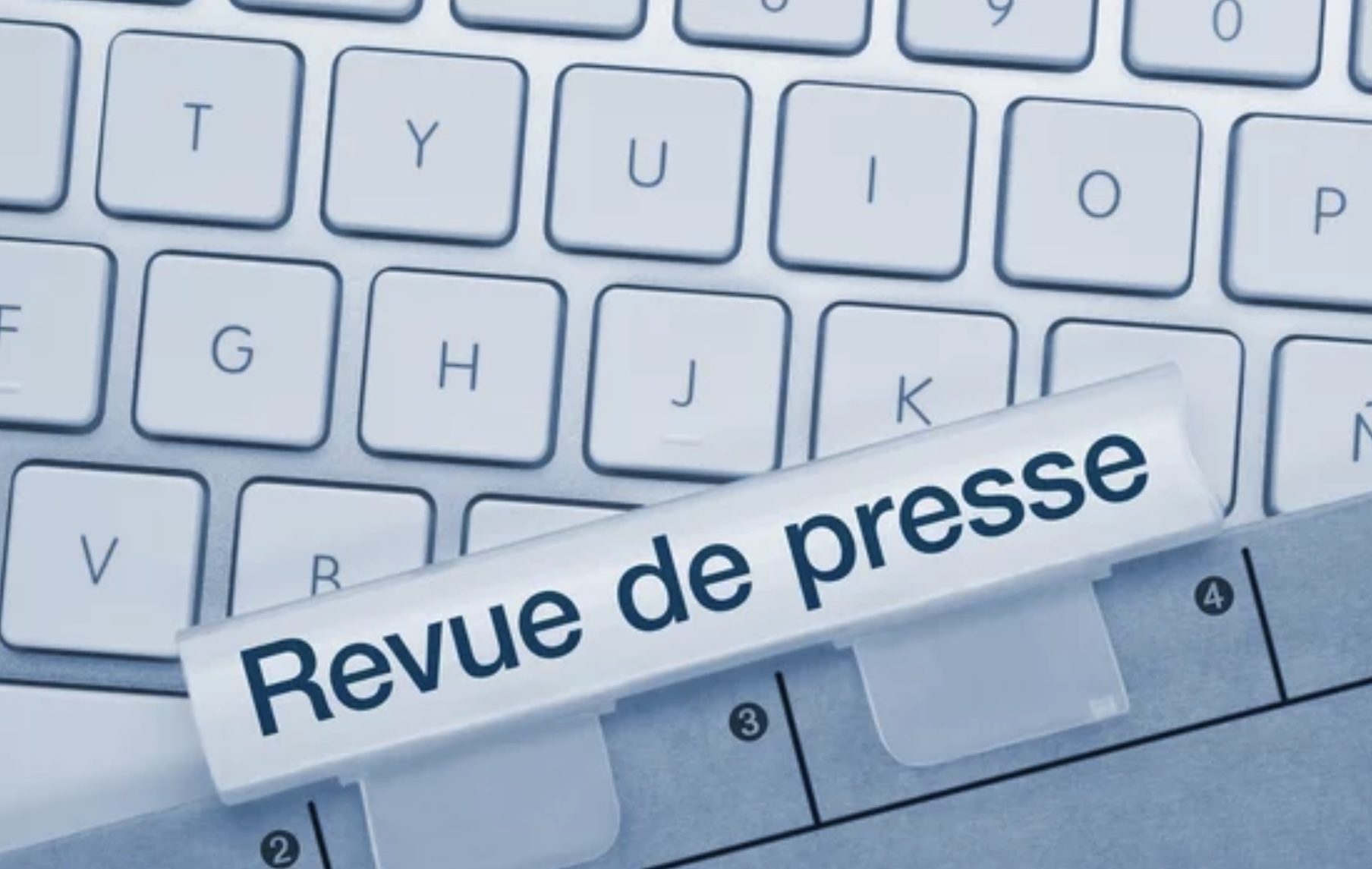Preuves vidéo : Quand les vidéos amateurs font-elles foi devant la justice en Suisse ? Les défis de l'IA et du montage

L'utilisation de vidéos amateurs comme preuves devant les tribunaux suscite de plus en plus d'intérêt, notamment avec la démocratisation des smartphones et des réseaux sociaux. En Belgique, la jurisprudence est claire : une vidéo, même filmée par un simple citoyen, peut être admise comme preuve. Mais en Suisse, et plus largement en Europe, la situation est plus nuancée. L'avènement de l'intelligence artificielle (IA) et les techniques de montage sophistiquées posent de nouveaux défis à l'authenticité et à la fiabilité de ces preuves.
L'admissibilité des vidéos amateurs : un principe en évolution
Traditionnellement, les preuves en justice étaient des documents officiels, des témoignages ou des rapports d'experts. L'arrivée des vidéos amateurs a bouleversé cette donne. Elles offrent un témoignage direct et visuel d'événements, souvent pris sur le vif et sans manipulation apparente. Cependant, leur admissibilité est soumise à certaines conditions. Le juge doit s'assurer de la pertinence de la vidéo par rapport aux faits, de son authenticité et de sa fiabilité.
En Belgique, la jurisprudence a largement ouvert la voie à l'admission de telles preuves, considérant que la simple possibilité d'une manipulation ne suffit pas à les disqualifier. En Suisse, la tendance est similaire, mais avec une prudence accrue, notamment en raison des risques liés aux manipulations numériques.
Les risques liés au montage et à l'IA
Le principal obstacle à l'utilisation des vidéos amateurs comme preuves réside dans la possibilité de manipulation. Les techniques de montage vidéo sont devenues de plus en plus accessibles et sophistiquées, permettant de modifier des images, d'ajouter des sons, voire de créer des vidéos entièrement fausses (deepfakes).
L'intelligence artificielle aggrave encore cette situation. Des algorithmes d'IA peuvent générer des vidéos hyperréalistes, indiscernables des enregistrements authentiques. Il devient alors extrêmement difficile de prouver la manipulation d'une vidéo, même pour des experts.
Comment garantir l'authenticité des preuves vidéo ?
Face à ces défis, plusieurs pistes sont explorées pour garantir l'authenticité des preuves vidéo :
- L'analyse technique : Des experts en informatique forensique peuvent analyser la vidéo à la recherche de traces de manipulation (erreurs de compression, incohérences dans la lumière, etc.).
- Le témoignage du réalisateur : Le témoignage de la personne qui a filmé la vidéo peut être crucial pour établir son authenticité et son contexte.
- La comparaison avec d'autres preuves : La vidéo peut être comparée à d'autres preuves (témoignages, documents, etc.) pour vérifier sa cohérence.
- L'utilisation de la blockchain : La technologie blockchain pourrait permettre de créer un registre immuable des vidéos, garantissant ainsi leur intégrité.
Conclusion : Un équilibre délicat à trouver
L'utilisation des vidéos amateurs comme preuves devant la justice représente un enjeu majeur. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la volonté de faciliter l'accès à la justice et la nécessité de garantir la fiabilité des preuves. Les tribunaux doivent faire preuve de prudence et d'expertise pour évaluer l'authenticité et la pertinence de ces vidéos, en tenant compte des risques liés au montage et à l'intelligence artificielle. La sensibilisation du public aux dangers des deepfakes et des manipulations numériques est également cruciale pour lutter contre la désinformation et préserver la confiance dans le système judiciaire.